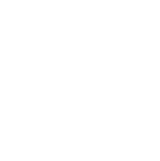Introduction
Dans l’espoir d’améliorer leur situation économique, les conjoints Gheorghe 1, leur fils adolescent Vadar et sa jeune femme — Roms roumains — ont commencé, autour des années 2000, des allers-retours entre leur village en Roumanie et Milan (Italie), circulant entre bidonvilles au fil des évacuations. Les enfants des deux couples sont restés vivre en Roumanie jusqu’en 2007 lorsque, suite à l’incarcération de Vadar et à l’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne, ils ont rejoint les adultes à Milan. C’est grâce à la présence de ces derniers que, à la suite d’une évacuation, la famille est intégrée dans un projet d’insertion pour Roms pendant deux ans, après quoi ils retournent à la rue dans un camp non autorisé, évacué quelques mois plus tard. Grâce à la médiation d’un groupe de militants, la mairie met à disposition pour les femmes et les enfants évacués un hébergement temporaire dans une chambre commune au sous-sol d’un centre d’hébergement pour sans domicile fixe où les femmes et les enfants Gheorghe passent un mois avant de regagner un camp non autorisé, évacué onze jours après leur arrivée. Ils cherchent alors, sans succès, à regagner des bidonvilles de plus en plus dissimulés, mais les interventions policières s’enchaînent. Alors, grâce à une collecte d’argent organisée par une institutrice de l’école fréquentée par les enfants, ils couvrent la remorque ouverte de leur camionnette qui fait office de chambre à coucher et de cuisine pour les neuf membres de la famille (six enfants et trois adultes).
Quelques semaines plus tard, une casserole pleine d’eau bouillante se renverse sur Mme Gheorghe et sa petite fille de six ans. Après leur hospitalisation, les adultes et les enfants plus âgés (qui abandonnent le collège) recommencent leurs allers-retours entre le village et Milan, où ils récoltent de l’argent, tandis que les enfants plus jeunes restent en Roumanie, où ils décrochent eux aussi de l’école. Si cette solution est pour la famille une configuration temporaire d’habitat transnational précaire, les militants qui les avaient aidés perçoivent ce retour au village comme un véritable échec, voir un décrochage de la famille d’une tentative de parcours d’insertion.
Comme la trajectoire des Gheorghe le montre bien, les lois de l’habitat précaire sont le fruit de l’imbrication entre les politiques publiques locales, les situations d’interaction à l’échelle locale et les trajectoires des familles. Cet article examine l’articulation entre ces différents aspects à travers le cas d’un bidonville milanais soumis à l’acharnement des forces de l’ordre pendant la période 2006-2011 2. Il cherchera à montrer les éléments de continuité entre les logiques des acteurs étatiques et les militants, qui sont pourtant animés par des intentions très différentes.
Les camps non autorisés et non tolérés
Le parcours des Gheorghe s’inscrit dans une conjoncture historique très spécifique 3 marquée, entre autres, par la politique d’expulsion continue de la mairie de Milan sous le gouvernement local Moratti (2006-2011) 4, l’ère de l’emergenza nomadi (état d’urgence nomades) en Italie, l’entrée de la Roumanie dans l’UE et les circulations migratoires entre la Roumanie et l’Europe de l’Est. Il soulève tout particulièrement la question de l’habitat précaire propre aux populations roms migrantes. Il s’agit des campements non autorisés présentant un certain nombre de caractéristiques typiques des marges urbaines, comme la situation périphérique et la présence d’activités polluantes dues aux industries ou aux décharges. En raison de leur composition sociologique, ils forment des « enclaves ethniques 5 » habitées presque exclusivement par des Roms. Ils peuvent enfin être définis comme des « espaces en suspension », c’est-à-dire « des lieux exilés et placés en dehors du système spatial et juridique auquel ils appartiennent 6 ». La police de Milan opère une distinction entre les camps non autorisés et non tolérés, qui font l’objet d’une politique de rejet, et les camps non autorisés mais tolérés qui vont à l’encontre des politiques de l’abandon 7. Si le traitement des premiers est caractérisé par un « gouvernement sans intervention 8 », les deuxièmes (dont la taille peut varier de quelques unités jusqu’à plusieurs centaines de personnes) font l’objet d’une action étatique et militante qui mérite d’être analysée.
La fabrique des familles « sans camp fixe »
Les campements non autorisés et non tolérés se situent sur des terrains vagues publics ou privés peu visibles, ou bien des anciennes aires industrielles, des bâtiments désaffectés, des aires de repos ou d’espaces en contrebas de ponts dans des zones périphériques du territoire intra-muros et extra-muros.
Les occupants, qui font généralement partie d’une famille élargie ou d’un réseau de familles provenant du même village en Roumanie, s’installent dans des baraques construites avec du matériel de récupération, dans une tente ou tout simplement sur un matelas soit à l’intérieur d’immeubles abandonnés soit à la belle étoile.
Livrer un instantané de la vie sur un camp non autorisé et non toléré à un moment donné risquerait d’en donner une impression statique, alors même que la vie dans un campo n’est pas nécessairement une condition permanente, comme la trajectoire des Gheorghe l’illustre bien. La précarité de ces types d’habitat a pour conséquence la forte mobilité des habitants, qui peuvent quitter le camp, temporairement ou d’une manière permanente, pour rentrer au pays, intégrer un projet d’insertion, se déplacer dans un campo nomadi municipal ou dans un logement temporaire offert par la mairie ou par une institution caritative (souvent à la suite d’une expulsion), déménager dans un logement privé ou public (HLM) trouvé et payé soit par la famille elle-même soit par des militants ou des institutions caritatives ou, tout simplement, circuler entre différents bidonvilles au rythme des expulsions.
Grâce aux fonds alloués par le ministère de l’Intérieur dans le cadre de l’emergenza nomadi 9, le gouvernement municipal de Milan (2006-2011) a intensifié le rythme des expulsions jusqu’à de véritables « cycles d’expulsion » : l’occupation d’un camp était suivie, plus ou moins rapidement, par sa destruction, puis par une période d’errance des habitants jusqu’à la réoccupation du même camp ou d’une aire voisine et, enfin, par une nouvelle expulsion. Ces cycles permettent aux forces de l’ordre de tenir sous contrôle l’aire occupée et ses habitants par des menaces constantes. Cependant, ils touchent un nombre restreint de Roms, qui ne font jamais l’objet ni d’une politique de reconduite à la frontière ni d’une politique d’insertion. Derrière une apparente « tolérance zéro » se cache une tolérance implicite vis-à-vis de la réoccupation des lieux, de manière à, comme le dit Michel Agier 10, créer des indésirables, puis montrer qu’on sait les gérer.
Les pouvoirs publics reconnaissent ainsi implicitement aux Roms les droit de rester sur le territoire, à condition de se soumettre aux maltraitances et menaces policières, à une situation de vie indigne et aux évacuations régulières. Ces conditions recouvrent les trois « formes de méconnaissance » ou de « négation de la reconnaissance 11 ». Primo, la destruction systématique et répétée des biens personnels et des logements est la seule forme de violence légitime pour les forces de l’ordre et elle est d’autant plus puissante que le logement peut être considéré comme l’équivalent symbolique du corps de la personne. Deuxièmement, les Roms des camps non tolérés sont exclus des droits normalement garantis à l’intérieur d’une société par le biais des expulsions qui les maintiennent dans des conditions de vie que l’on ne tolérerait pas pour d’autres personnes 12. Enfin, une forme de mépris et de dénigrement des modes de vie individuels ou collectifs consiste en un jugement négatif de la valeur sociale de l’ensemble des minorités roms. La municipalité reconnaît les Roms en leur donnant une place très précise dans l’ordre social, comme le font les forces de l’ordre françaises vis-à-vis des jeunes issus de minorités visibles :
Cet ordre social est celui d’une inégalité (entre le policier et le jeune) et d’une injustice (au regard du droit et simplement de la dignité) qu’il faut apprendre dans son corps. La répétition des mêmes expériences dans une routine mortifiante est une véritable éducation physique au cours de laquelle on intériorise sa place sociale. L’habitude de l’humiliation doit produire l’habitus de l’humilié 13.
Les habitants roms des bidonvilles, quant à eux, apprennent l’injustice et intègrent cette relation de sujétion renonçant aux revendications. Faute d’alternatives, payer le prix de l’humiliation reste la manière la plus facile de subvenir à leurs besoins. Cela n’empêche pas qu’ils développent des stratégies pour gagner la bienveillance des riverains de manière à augmenter les chances de se faire tolérer. C’est le cas des Gheorghe, qui trouvent des solutions de logement grâce à leur « bridging social capital 14 », c’est-à-dire des liens avec les policiers affectés à leur quartier, avec des membres d’associations, des travailleurs sociaux de la mairie ou des riverains. En revanche, dans les situations où ils étaient dépourvus de « bridging social capital » avec le quartier, ils ont été beaucoup plus vulnérables : il n’ont pas été alertés lors des expulsions perdant beaucoup plus d’objets personnels, ils ont subi des mauvais traitements de la part des policiers et ne se sont pas vu offrir une proposition de relogement. Le rôle des militants résulte donc aussi stratégique que celui des acteurs étatiques. Pour mieux comprendre cet aspect, considérons le cas de Rubattino.
Du militantisme compassionnel
Bien que Rubattino possède les caractéristiques des marges urbaines typiques des campements roms et qu’il ait fait l’objet de la politique de rejet, ce camp présente des aspects qui lui sont propres, dont la présence du premier véritable comité de soutien en ville. C’est le comité de soutien des Roms qui a gagné le plus de visibilité dans l’espace public (local et national) grâce à la mobilisation émotionnelle que les militants ont réussi à créer autour de ces familles. Retracer l’histoire et les logiques derrière ce mouvement nous permettra de montrer les conditions de possibilité d’un continuum entre deux groupes d’acteurs sociaux apparemment opposés : les acteurs étatiques et les militants. Les différents bidonvilles détruits et reconstruits à plusieurs reprises, connus comme le « camp de Rubattino », doivent leur nom à une avenue à la frontière entre deux quartiers milanais qui relie Milan à une autre commune. Malgré un plan de requalification urbaine, l’aire demeure abandonnée, à l’exception d’une centrale, de l’usine Innse et d’une zone militaire. Caractérisée par le périphérique, des voies ferrées et l’un des fleuves les plus pollués d’Europe, c’est une zone idéale pour une occupation non autorisée. Le boulevard est longé par des zones industrielles désaffectées, parmi lesquelles un ancien hangar démoli — plutôt caché — occupé par un groupe de familles roms.
Comme pour tout campement rom, un déni d’existence réciproque s’instaure au départ entre ses habitants et les riverains, qui considèrent le bidonville comme un espace immoral. Malgré les nombreuses expulsions, les familles réoccupent toujours des zones avoisinantes. Les premiers contacts avec la société locale avaient été tissés par une partie de ces familles en 2007. Alors installées au bidonville de Chiaravalle, ils avaient connus la communauté de Sant’Egidio à la suite du décès d’une petite fille de quatre ans qui était tombée dans un fossé d’irrigation à côté du bidonville. Les liens entre la communauté et les familles se fortifient et, au printemps 2008, les premiers enfants sont scolarisés dans le quartier Rubattino, où ils s’étaient déplacés entre temps. À l’école, on est d’abord inquiets et un groupe de parents écrit au ministre de l’Éducation pour demander l’éloignement des écoliers roms. Ensuite, grâce à la médiation de Sant’Egidio, les habitants du bidonville tissent les premiers liens avec des parents, des institutrices et d’autres riverains. Entre-temps, le camp s’élargit et les conditions de vie s’aggravent. Rubattino compte autour de 350 personnes lorsque la mairie s’apprête à l’expulsion. Profitant de l’inscription de 36 nouveaux écoliers roms, les bénévoles de Sant’Egidio sensibilisent quelques institutrices et mères d’élèves, qui commencent à afficher des pancartes et à recueillir des signatures contre l’expulsion. Elles interviennent également au conseil d’arrondissement, organisent un défilé aux flambeaux et une rencontre publique.
Panneaux avec la convention relative aux droits de l’enfant (archives de Stefano Pasta)
Crédits - Stefano PastaLe jour de l’expulsion devient un symbole. L’école ouvre ses portes pour accueillir les familles évacuées, pendant que parents, enseignants et militants leur cherchent un abri pour la nuit, y compris chez eux. Alors que le milieu associatif historiquement mobilisé en faveur des Roms manifeste devant la préfecture, le mouvement de riverains baptisé « mères et institutrices de Rubattino » accompagne les familles devant une paroisse pour demander un abri pour une nuit : au militantisme politique s’ajoute un militantisme plus compassionnel. Ce mouvement connaît rapidement un véritable succès médiatique et politique, grâce à l’appui, plus ou moins direct, d’associations liées à l’univers scolaire et social, de riverains, d’institutrices, de parents, de journalistes, de conseillers municipaux ou d’arrondissement et du monde catholique, comme le cardinal de la ville et les journaux Famiglia Cristiana 15 et Avvenire. Après un peu plus d’un an d’existence, les militants remportent la médaille du mérite civique de la ville de Milan. Fort de ce succès, le mouvement multiplie ses actions publiques, dénonçant la politique des expulsions et l’infraction du droit à la scolarisation (à travers des manifestations, des lettres aux journaux et des pancartes accrochées aux tentes) et apportant de l’aide matérielle aux familles, voir même des mini-projets d’insertion.
Du militantisme pro-Rom à l’engagement pour l’enfance
La spécificité du mouvement et sa réussite résident dans sa discontinuité vis-à-vis du militantisme pro-Rom. Sa crédibilité et son succès politique sont dus à un apparent paradoxe : il ne recourt pas au langage politique. Ce choix délibéré s’exprime avant tout dans le nom adopté (qui renvoie au champ de l’enfance), mais aussi dans la manière de le présenter (comme un groupe de riverains plutôt que de militants) et dans les arguments utilisés (la protection de l’enfance plutôt que le droit à l’insertion et au logement). Très différent sera le sort du « Groupe de soutien Forlanini » né à la même période et qui se présente explicitement comme une force de gauche, ne suscitant guère d’intérêt aux yeux de la presse, davantage intéressée par un groupe de femmes sensibles à l’univers de l’enfance. Plus que des militants, le mouvement de Rubattino est formé par des citoyens qui franchissent les frontières morales implicites entre le bidonville et le quartier. Cela est possible grâce aux nouvelles identités acquises par les Roms suite à la scolarisation, celles d’écoliers et de parents d’élèves : des identités qui, contrairement à celle des Roms de bidonvilles, sont acceptables, possibles et souhaitables 16. Les parents d’élèves (surtout des mères) éprouvent de la solidarité envers d’autres parents menacés d’expulsion et les institutrices se sentent responsables de leurs écoliers. Vus sous un nouveau jour, celui de la victime, les Roms suscitent moins de peur que de compassion 17. Le statut de parents d’élèves a notamment permis de déclencher un mécanisme de reconnaissance par la solidarité et un mouvement affectif entre semblables 18. Cette compassion se fonde sur la reconnaissance de l’autre comme un autre soi-même et implique un engagement non pas pour des causes abstraites, mais pour « une cause incarnée, qui affecte des personnes singulières, qu’ils connaissent au moins de vue, et qui relève d’une forme de proximité 19 ». Les actions du mouvement s’organisent autour de l’exigence morale d’agir 20, guidée par des sentiments d’indignation et de colère ressentis devant une injustice. Plus que sur le terrain des revendications politiques, les requêtes jouent sur celui des sentiments moraux partagés, avant tout autour de l’enfance. La stratégie de communication du mouvement est organisée autour de la médiatisation des histoires de leurs Roms. Les lettres, les articles des journaux et les émissions télévisées racontent les histoires d’enfants et de leurs parents avec un prénom, un visage et un parcours de vie : des enfants-héros qui s’obstinent à aller quotidiennement à l’école en dépit des quatre heures de transports en commun par jour, sans se soucier de la pluie, de la boue et du manque de vêtements, les leurs ayant été détruits par la police. Ce témoignage direct relate des expériences personnelles, des émotions et des récits de souffrance. Et les dessins des enfants réalisés lors d’activités organisées par la communauté de Sant’Egidio sont présentés lors de l’exposition : « Io vivo al campo. Storie di bambini rom a Milano » (J’habite au camp. Histoires d’enfants roms à Milan).
Dessin d’enfant de l’exposition « J’ai peur qu’ils nous fassent partir » « No ! » (archives de la communauté de Sant’Egidio)
Crédits - Communauté de Sant’EgidioLe but de ces histoires singulières est de susciter la pitié des lecteurs 21. Une stratégie gagnante car la presse locale change la représentation des enfants et des parents roms des bidonvilles dans l’espace public local. Si auparavant il était question des Roms dangereux desquels la mairie protégeait les riverains, les articles parlent désormais d’enfants innocents dont la seule faute est celle d’être nés Roms et de jeunes parents qui cherchent à tout prix à donner un futur à leurs enfants.
Une reconnaissance limitée
Confrontés à l’expérience directe de la souffrance, les militants éprouvent un attendrissement qui ouvre la possibilité d’une intervention en tant que bienfaiteurs. Le sentiment d’urgence prévaut sur le reste :
L’urgence de l’action à mener pour faire cesser les souffrances invoquées l’emporte toujours sur la considération de la justice 22.
En l’occurrence, le mouvement n’a pas permis aux Roms de devenir des sujets politiques, ce qui amène à nuancer l’idée d’une abolition totale des frontières morales de la part du mouvement de Rubattino. Bien que le mouvement ait remodelé ces frontières, elles continuent d’exister. Ces sont des parents non roms qui se mobilisent au nom et pour la défense des Roms. Lors des manifestations publiques du mouvement, les Roms sont relégués presque uniquement au rôle d’invités. Les relations entre militants et familles de Rubattino montrent bien que le degré de reconnaissance entre « sujets » doit être nuancé. Par ailleurs, les militants tendent souvent à glisser vers des formes d’assistanat et de travail social. En effet, les activistes s’engagent dans de véritables prises en charge des familles avec des accompagnements individualisés. En dépit d’un supposé statut égalitaire entre parents, les disparités typiques des relations compassionnelles sont bien présentes 23. La tendance à négliger l’autonomie d’appréciation et de décision des Roms tient à leur infantilisation et à une vision normalisatrice de la famille de la part des militants. Dans les entretiens, les militants nomment les Roms dans une phrase construite au passif, les présentant comme des personnes dépendantes dont il faut s’occuper. L’expression « être sage », formule normalement utilisée avec les enfants et que les bénévoles emploient en s’adressant aux parents, montre bien l’infantilisation à l’œuvre. Plus qu’à des militants, ils ressemblent parfois à des travailleurs sociaux et il est possible d’apprécier le continuum entre leur travail professionnel et leur engagement. Il s’agit, malgré tout, d’éduquer les Roms à bien exercer le métier de parents.
Conclusions
La trajectoire des Gheorghe tout comme le cas de Rubattino montrent bien que l’habitat précaire ne peut pas être analysé uniquement sous l’angle de la relation entre les pouvoirs publics et les habitants des bidonvilles. Au contraire, une série de variables contribuent à modifier les trajectoires des familles roms précaires, avant tout les réseaux sociaux et le capital social des familles, ainsi que leur capacité à gérer les situations d’interaction à l’échelle locale. La présence d’enfants, surtout en âge scolaire, s’avère une ressource particulièrement précieuse dans la gestion quotidienne de la vie en migration et notamment dans le processus de « frontiering 24 », c’est-à-dire de création de liens dans le pays d’accueil. Les sentiments moraux, parfois contradictoires et ambigus, que les enfants soulèvent — généralement peu considérés, voire carrément négligés — permettent de remanier les frontières morales en suscitant, surtout lors d’épisodes dramatiques, des émotions diverses (la compassion comme l’indignation) qui entraînent l’exigence morale d’agir. Perçus comme innocents, vulnérables et « exemplaires », les enfants arrivent à toucher le cœur de nombreux riverains : la peur et l’indifférence laissent place à un mécanisme de reconnaissance par la solidarité et à un mouvement affectif, lorsque les Roms sont perçus comme semblables. Ces mobilisations arrivent à franchir, au moins en partie, les frontières morales implicites qui séparaient ces groupes les heureux des malheureux. Certes, les rapports sociaux de pouvoir ne parviennent pas à être complètement effacés et il manque encore beaucoup avant que les Roms soient considérés comme des sujets politiques et moraux à part entière.
Pour conclure, l’ambiguïté entre méconnaissance et reconnaissance des Roms comme sujets est à l’origine à la fois du gouvernement des corps que tente d’exercer la police et des pratiques infantilisantes des militants. Cela dit, l’équilibre entre méconnaissance et reconnaissance n’est pas le même entre ces deux groupes d’acteurs et, surtout, le contenu de leur actions est diamétralement opposée : les uns évacuent, les autres cherchent à donner un logement convenable.