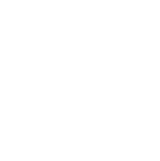À partir de la seconde moitié du XXe siècle, Beauduc, plage du littoral camarguais, fait l’objet d’une appropriation sociale de l’espace relevant des couches populaires locales. Ces dernières érigent des installations sans droit ni titre formant le siège de pratiques ordinaires de nature : pêche, chasse, cueillette. L’habitat temporaire qui en résulte emprunte sans complexe à divers modèles, cabanon de pêcheur de type « provençal », caravane, bus, container, mobil-home... Le principe de construction y est en effet régit par une stricte économie de la récupération mais aussi de l’échange qui aboutit à deux caractéristiques majeures pouvant définir cet habitat temporaire. Un caractère esthétique fortement hétéroclite du fait de ce mélange de genres et un caractère sociologique très marqué, éminemment populaire, qui s’appuie sur une sociabilité intense favorisant l’entre-soi.
Situé en bordure de territoire, tant géographique, qu’administratif, juridique et social, cette improbable utopie populaire, pourtant effectivement réalisée 1, permet l’expression d’une citoyenneté active, pleine et entière où l’habitant prend en main, le temps d’une saison, parfois davantage, la maîtrise des affaires de sa cité, définissant ses propres règles du « vivre ensemble » tout en s’ajustant au milieu. Car une troisième caractéristique vient définir cet habitat, son extrême adaptabilité. L’ajustement de la pratique habitante au milieu naturel comprend un ensemble de manières d’être et de faire s’apparentant à ce qu’on qualifie volontiers aujourd’hui de mode de vie écocompatible : faible empreinte écologique, habitat réversible, recyclage de matériaux, autonomie énergétique... Il est également un autre type d’adaptation à laquelle recourent les habitants qui consiste cette fois à s’ajuster aux pressions récurrentes de la norme. Cette dernière s’exerce à travers l’appareil politique, qu’il s’agisse de la norme administrative, juridique ou sociale et contre laquelle va se heurter incessamment cette pratique habitante spontanée, sorte de citoyenneté « sauvage », improvisée et libre essayant de faire valoir son expression, mais confrontée à quelques difficultés à faire entendre sa voix 2.
Les caractéristiques d’adaptabilité de la pratique habitante
Le milieu lagunaire dans lequel s’insèrent ces établissements humains se caractérise avant tout par une profonde dimension d’instabilité et de précarité avec laquelle l’habitat beauducois, à l’instar d’autres types d’habitat vernaculaire sous d’autres latitudes, semble entrer en résonance par la prise en compte de cet environnement. En dépit de cette adéquation au milieu demeurent les aspects hors normes et hors-la-loi de ce type d’installation sur le littoral, obligeant les usagers-habitants à s’adapter également à la norme administrative, réglementaire et juridique.
Adaptation, ajustement au milieu
Pour répondre à cette mouvance et cette incertitude propres aux secteurs lagunaires en zone deltaïque, les établissements humains y optent pour un type d’habitat fortement évolutif, prompt aux changements et aux évolutions naturelles et sociales pouvant survenir au fil du temps. Par exemple, les points hauts (difficilement décelables pour un non averti, en dehors des dunes, dans un milieu que caractérise la platitude) sont investis, confortés ou créés de toutes pièces pour contrer les phénomènes ponctuels d’inondation. L’habitat est « pensé » conçu le plus souvent entre véhicule et maison, il pourrait presque être considéré comme un « simple » élément de l’équipement familial 3, au même titre que la glacière, le parasol ou la tente au moyen desquels se pratiquent le camping. Les conditions naturelles propres au lieu obligent cependant la plupart des établissements humains saisonniers à plus d’organisation matérielle. En effet, les fréquentes tempêtes, les nuées d’insectes piqueurs, les épisodes d’inondations, l’absence d’abri végétal et enfin l’éloignement conduisent les usagers à opter préférentiellement pour des caravanes des camping-cars, des bus, des fourgons, éléments mobiles et rapportés qui serviront de cabanons 4. On peut encore déceler directement le caractère mobile et saisonnier de ces différents types de véhicules même lorsque ceux-ci ne forment qu’une partie de l’installation.
Cette part de mobilité se lit aussi dans le choix des matériaux ainsi que dans la structure même, régulièrement soumis à évolution, ce en lien étroit avec l’usager habitant suivant sa propre mobilité, sa saisonnalité, ses usages de l’habitation. Ainsi, suivant que la fréquentation est strictement estivale ou au contraire s’effectue tout au long de l’année, l’établissement concerné verra sa structure et son degré d’équipement technique changer du tout au tout pour parer aux conditions hivernales plus rustiques, voire répulsives.
Cet habitat autoconstruit engage ainsi de nombreux savoir-faire (bricolage, autonomie énergétique, récupération, échange) et différents savoir-vivre avec le milieu (inondations, moustiques, sables ensevelissants, tempêtes) dont la profonde hétérogénéité aboutit pourtant à la fabrication d’un style particulier d’habitat. Ce dernier offre en effet un caractère fortement personnalisé qui renforce précisément cette dimension d’hétérogénéité tout en veillant à son ancrage dans la réalité du « terrain ». C’est là une des spécificités du style particulier de cet habitat. Les dimensions humaines, sociales, personnelles et les dimensions « naturelles » y sont non seulement étroitement entremêlées mais font l’objet de redéfinitions incessantes et sont renégociées au fil du temps suivant les types d’évolution pouvant survenir, qu’elles soient le fait des habitants ou du milieu environnant lui-même. Dans un essai sur l’architecture « sauvage », Jean-Paul Loubès 5 pointe la « cécité » dont ont fait preuve les architectes et les urbanistes à l’égard de l’habitat dit informel que constituent à la fois le bidonville et la figure de la cabane.
Nous devons nous demander comment l’habitat informel peut “recharger” l’invention en panne dans le domaine de la production du logement 6.
L’auteur recourt à la notion de géopoétique — se référant en cela au poète et essayiste Kenneth White 7 — pour qualifier ces autres manières d’habiter qu’incarnent ces deux formes architecturales que sont le bidonville et la cabane. Il invite ainsi à porter notre attention à la réintroduction du sens dans l’acte d’habiter dont elles sont porteuses, c’est « habiter plus et plus loin » écrit-il 8, en ce qu’elles réintroduisent de la poésie dans l’acte d’habiter et en ce qu’elles permettent un lien plus direct à l’environnement dans leur emprise directe avec le milieu naturel dont elles dépendent l’une et l’autre très fortement. Pour autant, s’agit-il d’un réensauvagement de l’habitat dans cette reconnexion au dehors, à la nature ? La rupture avec la société urbaine, industrielle et de consommation n’y est en aucun cas manifeste, bien au contraire, cette nouvelle façon d’habiter s’y adosse. Elle y puise en effet les ressources nécessaires à la construction : matériaux déclassés, récupérés, rebuts... Un peu comme si cette nouvelle façon d’habiter recyclait sans complexe, sans jugement et sans état d’âme tous ces éléments selon l’optique pragmatique du ça peut toujours servir.
La ressource, le gisement de matériaux n’est plus la forêt et les végétaux qu’elle apporte, mais d’autres matériaux disponibles sur le site. On pourrait dire que ce qui tient lieu de “forêt” pour ces cabanes-là c’est la grande ville et ses rebuts 9.
Or cette « ruse » du détournement, riche d’invention, porteuse d’une économie de la débrouille constitue la raison même de sa condamnation parce qu’elle ne camoufle ni ne renie ce caractère et cette allure de bidonville tant décrié par ceux qui ne se fient qu’à l’apparence formelle et esthétique de cette architecture d’aubaine sans déceler le mélange de pragmatisme et de possibilité d’expression personnelle que contient cette fonction de recyclage et cette manière d’habiter. C’est là que se situe précisément tout l’enjeu de la deuxième catégorie d’adaptation à laquelle doivent faire face ces habitants : l’ajustement à la norme.
Adaptation, ajustement au politique
Cet ajustement à la norme s’impose à la pratique de trois manières différentes. La première s’établit par le truchement de l’appareil juridique ou policier et vise plus promptement, plus directement, l’éradication de l’objet de la pratique. La deuxième se réalise par l’action politique locale et obéit à des jeux d’acteurs parfois contradictoires mais visant, de manière prudente, à une forme de reconnaissance de la pratique mais au prix de sa normalisation ou de sa patrimonialisation. Et le prix à payer implique une importante transformation, voire une mutation radicale de la pratique. La troisième enfin se situe au niveau des politiques publiques, politique de gestion du risque 10 dans un espace littoral, politique de protection environnementale, elle est portée ici par le Conservatoire du littoral 11 et le Parc naturel régional de Camargue (PNRC 12) et ambitionne l’écologisation des pratiques. « Prise en tension 13 » entre ces deux visées adaptatives, la pratique va connaître différentes étapes dans cette tentative à faire entendre sa voix et à assurer son maintien au fil du temps.
De mon point de vue, la première étape est sans doute la plus riche sur le plan anthropologique car elle met en exergue une tentative de s’adapter en suivant toutefois le langage, les codes et valeurs propres à ce grand rassemblement populaire saisonnier qui rythmait à Beauduc le retour de la « belle » saison. Un peu comme une « seconde vie », cette effervescence sociale toute particulière ouvrait en effet sur la possibilité d’une réjouissance collective et sociale assez proche d’une sorte de carnaval, tel qu’analysé par Mikhaïl Bakhtine 14 comme figure centrale de la culture populaire. Un peu comme si s’exprimait là, de Rabelais à Fellini en passant par Kusturica, la possibilité laissé au peuple d’un langage subversif, critique et souverain dont la valeur de ressourcement et de bien-être peut toujours renaître en tout lieu, siècle après siècle, dans un grand éclat de rire aux forts relents utopiques.
Durant cette première étape donc, la modeste utopie populaire s’est mise en ordre de marche vers une autogestion qui se voulait congruente avec la norme. Répondant point par point aux « reproches » qui leur sont adressés 15, les Beauducois tentent de se « réguler » eux-mêmes, à leur manière. On assiste alors à un modelage de l’utopie et à l’enhardissement de la pratique répondant à l’objectif de gérer pour rester. La piste conduisant à Beauduc est régulièrement entretenue 16 afin de garantir l’accès et répondre ainsi à des objectifs de sécurité (acheminement des secours), une fosse collective d’aisance est installée pour les nombreux usagers afin d’apporter des solutions aux problèmes sanitaires, des camions-citernes recyclés sont acquis en cas d’incendie... L’ensemble de ces actions « citoyennes » s’exprime selon le langage propre au lieu suivant l’économie de la débrouille, l’échange, l’organisation de gigantesques banquets (jusqu’à 600 personnes), la rédaction d’une charte pour Beauduc, la création d’un blason identitaire...
La deuxième étape dans cette adaptation témoigne à l’inverse d’une dépossession totale de l’action par les habitants au profit d’un retour en force de l’État régalien avec la démolition d’une partie de l’objet et la tentative d’une labelisation-patrimonialisation d’une autre : diviser pour mieux régner.
Certes, les Beauducois ont fait montre d’une certaine capacité à gérer mais ils n’en demeurent pas moins hors-la-loi et une certaine partie d’entre eux fait l’objet d’une procédure judiciaire depuis plus de dix ans. Cette dernière avait été gelée suite à une importante manifestation dans la ville d’Arles pour le maintien de la pratique largement soutenue par les élus locaux 17 mais, à la fin 2004, l’application de la loi aboutit à des opérations de destruction et à la « reconnaissance » d’une partie de la pratique cantonnée dans un des quartiers du site sur les trois existants qui doivent, à part lui, disparaître. La directive territoriale d’aménagement (DTA) de 2007 prévoit en effet le maintien du quartier du « vieux village », noyau fondateur de la pratique, sis en dehors du domaine public maritime et correspondant à 77 installations 18. Le processus de reprise en main de l’État se poursuit avec une troisième étape qui vise cette fois l’écologisation des pratiques.
À partir de 2008, l’exploitation des salins en déclin économique se départit progressivement de la moitié de son foncier, dont la Pointe de Beauduc 19, en vendant ses terrains au Conservatoire du littoral. La gestion en est alors confiée aux institutions locales de protection de la nature dont le Parc de Camargue est le coordonnateur. L’enjeu écologique est de taille avec notamment la possibilité de réouvrir la lagune de Beauduc et de réintroduire ainsi une dynamique naturelle au sud d’un delta jusque là totalement endigué. La vocation environnementale de cet espace entraîne alors une profonde modification des usages en cours sur le site : la circulation automobile et le camping sauvage sont fortement restreints et les différentes pratiques balnéaires (pêche, baignade, sports de glisse) font l’objet d’une stricte répartition.
Plage de Beauduc : plan de gestion des usages et des accès
Crédits - Parc Naturel Régional de CamargueÀ partir de 2011, le Parc de Camargue met en place un plan de gestion concerté des usages qui donne lieu chaque année à de nouvelles transformations des pratiques. Un gabarit est installé sur la piste d’accès qui empêche désormais l’accès aux caravanes mais un dispositif dérogatoire permet encore durant quelques années aux adhérents des associations de pouvoir y accéder en caravane ou camping-car pour la saison estivale. Ainsi transformés, provisoirement, en « ayants droit », les usagers sont amenés à accepter les transformations progressives qui leurs sont présentées lors des réunions de concertation. Le processus de « renaturation » de cet espace s’accompagne également de changements toponymiques et de l’émergence d’un paysage politique 20 à travers la mise en place d’une signalétique visant la sensibilisation à l’environnement, la matérialisation d’espaces mis en défens, des chenaux de circulation..., l’irruption du paysage politique vise à sensibiliser les usagers aux nouvelles règles en vigueur mais aussi à délimiter, corseter, entraver, contenir, astreindre, interdire.
L’encadrement des usages concerne également les établissements humains avec la rédaction d’une « charte du cabanon » qui fixe un ensemble de prescriptions relatives à l’utilisation de certains matériaux, la récupération de l’eau, les normes sanitaires, les conditions de sécurité et la non transmissibilité des cabanes. À aucun moment le texte ne s’appuie sur les pratiques et les savoirs « indigènes » existants.
De l’insaisissabilité de l’objet
Les interventions sur le milieu de la part des habitants sont pourtant toujours de mises même si elles tendent à être plus « contenues » et « maîtrisées ». Elles concernent notamment l’accès au site avec la poursuite de l’entretien et la réfection, particulièrement coûteux, de la piste. De fait, un ensemble d’actions et de décisions s’effectuent sur le mode de la zone grise tel que l’ont déjà montré de très intéressants travaux de recherche sur des formes comparables de citoyenneté sauvage 21 :
On peut parler d’un processus croisé d’ensauvagement des institutions (une municipalité se met à procéder à tâtons, sur le mode de la zone grise sans formaliser ou officialiser son action) et de domestication de l’expérience sauvage (net renforcement de la part instituée et du poids des associations notamment, normalisation relative de ses habitants, etc.) 22
Ce mode particulier s’établit dans l’exercice de la confrontation entre ce type d’objet et le politique qui affectent et font évoluer l’une et l’autre des parties en présence : pratique habitante d’un côté, Conservatoire du littoral et Parc naturel régional de l’autre. Sont-elles le signe d’un simple ajustement à petite échelle et sous-tendues par des petits arrangements locaux pour motifs électoralistes ? Longtemps les services de l’État ont fermé les yeux sur ces pratiques d’autogestion du territoire, Beauduc est toléré, même s’il est aussi décrié localement voire stigmatisé comme un lieu de va-nu-pieds, de « beaufs », de « populo » dégueulasses qui se « bourrent la gueule » tous les week-ends ou, au contraire, loué, vanté, jusqu’à la pâmoison.
La part du milieu naturel interfère cependant fortement dans cette tentative de « domestication » de la pratique, au point que la nature rattrape parfois le politique dans sa volonté d’encadrer étroitement l’objet, s’en dessaisissant puis s’en ressaisissant tour à tour. L’exemple le plus représentatif de cette valse hésitation est en relation étroite avec la politique de gestion du littoral confrontée à un phénomène important d’érosion marine. Surpris par la rapidité de l’évolution du site, rebaptisé au passage « étangs et marais des salins de Camargue », depuis la dislocation des digues et les entrées d’eau marine, les décisions de gestion peuvent être rendues caduques, inopérantes voire contraires à l’objectif poursuivi. Beauduc se retrouvant en première ligne face à l’érosion devient dans ces conditions, un objet critique, pris dans une situation critique, pour le politique. Dans leur confrontation avec ces pratiques habitantes, les services de l’État se retrouvent sur le fil du rasoir. Dès lors il s’agit d’éviter à tout prix de reconnaître le caractère mobilier — a fortiori immobilier — des biens mais plutôt de sécuriser les personnes, de garantir leur évacuation.
Dans le même temps, cet exemple témoigne de l’incapacité du politique à se saisir de ces formes citoyennes « sauvages », parfois pourtant innovantes en matière de savoir-vivre avec le risque, à s’appuyer sur elles, à les intégrer ou plus prosaïquement à les faire participer à la réflexion sur la gestion et le devenir de ces espaces. Il convient ici de faire une distinction entre le fait de consulter, de concerter des usagers dans le déroulement des différentes décisions de gestion touchant à la transformation de la pratique et celui de les faire participer qui supposerait une co-construction de ces transformations s’appuyant sur l’existant, sur le déjà là, sur le déjà fait... Pourtant la valorisation de cet existant, valorisation des pratiques, de l’habitat, du rapport à la nature pourrait être judicieusement utilisé comme un levier d’action dans la co-évolution des rapports hommes milieux.
Faut-il lire cette non prise en compte des pratiques comme le résultat d’incapacités citoyennes de la part des usagers à les faire valoir dans l’espace de la concertation publique ? Ou bien est-ce le regard porté (mépris, infantilisation, misérabilisme, folklorisation) par les acteurs publics sur ces pratiques qui de facto en inhibe les ferments de propositions et/ou de revendications et les rend sourd à leur éventuelle prise en compte ?