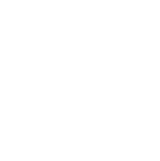Avant-propos
De septembre 2010 à juillet 2012, j’ai mené, dans le cadre de mon master de sociologie de l’Université Paris VIII, une enquête portant sur plusieurs friches de Seine-Saint-Denis. Je m’y suis intéressé de manière opportuniste en devenant, par l’entremise de mon directeur de mémoire (Daniel Terrolle), l’assistant officieux d’une anthropologue engagée dans un projet pluridisciplinaire ayant pour vocation une étude de la diversité des plantes, des oiseaux, des papillons, des hommes et de leurs traces dans les friches urbaines de la Seine-Saint-Denis
. Vingt-et-une friches devaient dès lors être « étudiées » au travers des prismes de l’anthropologie, de l’écologie et de la photographie documentaire. Peu de temps après mon arrivée cependant, de trop grandes divergences paradigmatiques et méthodologiques menèrent à l’arrêt prématuré du projet. J’ai ainsi poursuivi seul.
Parmi les vingt-et-une friches de l’échantillon originel, j’ai recentré mon enquête sur une friche qui avait pour double avantage d’être très proche de mon université et d’héberger une grande diversité d’usages et d’usagers. En outre, cette friche se trouvait partagée entre plusieurs communes désormais réunies sous l’égide de la communauté d’agglomération Plaine Commune 1 — ce qui laissait entrevoir des éléments de gouvernance intéressants — et avait pour particularité d’être une friche agricole en milieu urbain dense là où la majorité des friches sont des friches industrielles. J’ai donc été séduit par ce composite idéal-typique et, plutôt que d’étudier ce qui se fait traditionnellement dans l’étude sociologique des friches — à savoir les questions de gouvernance et les projections urbanistiques — j’ai préféré y porter un regard plus micro-sociologique. Outre l’usage de méthodes « classiques » d’observation participante et d’entretiens, j’ai eu recours à l’observation flottante mise en place par Colette Pétonnet 2 et aux entretiens informels. L’échantillon, conditionné par le terrain, n’est pas pléthorique. Au total, 28 personnes furent rencontrées sur la friche. Parmi ces 28 personnes, 9 constituent le cœur de l’étude (car occupant très régulièrement la friche) et furent suivies durant les deux années de l’enquête « officielle » puis encore un an après l’obtention de mon master de manière plus épisodique. Le reste de l’échantillon fut constitué autant de rencontres multiples conditionnées par le hasard que de rencontres uniques. Chaque fois néanmoins, un entretien informel fut réalisé afin de capitaliser ces rencontres.
Le titre de cet article, « le champ des possibles », est d’abord une référence aux hétérotopies de Michel Foucault, texte qui a beaucoup guidé mes recherches 3. Sans bibliographie concluante sur le sujet, il m’a fallu faire preuve d’imagination sociologique car, comme dit plus haut, les recherches actuelles portant sur les friches se concentrent sur des questions de gouvernance ou enquêtent au sein de « friches » artistiques qui n’ont plus de friche que le nom, mais jamais sur la nature de ces espaces ni sur les usages spontanés qui peuvent y être observés (exception faite des chercheurs spécialisés dans les questions migratoires ou les sans logis et pour qui les friches sont des décors mais jamais des objets en tant que tels). Aussi, si les friches ne répondent pas entièrement à la typologie dressée par Michel Foucault, celle-ci m’a permis de constituer une grille de lecture de ces espaces.
Ce titre est ensuite un jeu sur le fond et la forme. Comme bien souvent, un sujet de recherche est le fruit d’affinités électives et on le choisit autant qu’il nous choisit. C’est au cours de mon enquête que je me suis aperçu que ma rencontre avec les friches n’était pas si hasardeuse. Enfant, alors que je vivais en Seine-Saint-Denis, mon père m’emmenait jouer dans « le champ » d’où je revenais souvent avec des pantalons troués, au grand désarroi de ma mère. Nous y promenions nos chiens et j’y voyais un terrain d’aventure parsemé de dangers où, selon mon père, il y avait des sables mouvants et où je glissais le long des pentes assis sur un carton. Ce champ, lui et ses amis l’avaient eux-mêmes connu en tant qu’enfants puis adolescents. Cette ancienne champignonnière utilisée durant l’Occupation comme maquis puis laissée à l’état de friche était le lieu idéal pour des expéditions spéléologiques, des parties de chasse à l’homme ou des courses de moto-cross. Au-delà du lien affectif que j’ai pu entretenir avec une friche durant mon enfance, cette expérience personnelle a résonné avec celles d’autres enquêtés rencontrés sur la friche ou lors de discussions périphériques avec des personnes ayant eu un rapport avec une friche au cours de leur vie, comme ce fut notamment le cas avec Saïd Bahij cité en introduction. Ces espaces, en apparence vierges, devenaient des lieux à part entière.
Introduction
Nous on a quand même des souvenirs d’enfance qui sont précis, que les jeunes maintenant n’ont plus parce qu’ils n’ont plus cet espace. Ces espaces vitaux qui étaient là, naturels, les terrains vagues tout ça. Et des gens sont venus, ont fait des travaux, sans se soucier que là, nous, on avait toute notre jeunesse, et ils viennent, ils construisent des trucs où maintenant on fait la queue pour retirer 100 francs.
Terminus de la ligne 13. À la sortie du métro, la RATP met à disposition un plan afin d’aider les usagers à s’orienter. L’espace y est disséqué, répertorié et parcellé. L’image est composée d’une multitude de signes. Des formes géométriques de différentes couleurs symbolisent l’espace et nous permettent de le mentaliser, des légendes nous permettent de donner du sens à ces éléments et de les nommer : se dessinent alors en notre esprit rues, routes, bâtiments, parcs et jardins. Mais au cœur de cette sémiologie une grande masse verte interpelle, aucune légende ne renseigne le lecteur. Serait-ce un parc ? Une forêt ? Pourquoi cet espace n’est-il pas répertorié et qualifié sur le plan ?
À quelques pas de la station, en bordure de rue, apparaît alors un étonnant paysage, contrastant avec la froideur du béton et la rigueur qu’il inspire, une végétation en apparence désordonnée et touffue se tient là, c’est un terrain vague. Dans la ville alentour, la nature est matée : les pelouses sont tondues, les arbres élagués, leurs pieds minéralisés. Les rues, trottoirs et places sont sans obstacles, à la vue comme au passage. On peut voir et être vu, ce qui rassure et assure la surveillance.
Dans le terrain vague, l’abondante végétation opacifie l’espace pourtant ouvert. On y pénètre d’un pas hésitant, jaugeant progressivement l’irrégularité inhabituelle du sol, esquivant les orties tout en étant ralenti par quelques gaillets gratterons. Et puis, au terme de ces tâtonnements, les sens alertent. On constate que les sons de la ville se sont feutrés : le bruit sourd des voitures au loin laisse alors la place à une certaine quiétude ponctuée par quelques chants d’oiseaux. L’air n’est plus uniquement teinté d’asphalte et d’hydrocarbures mais présente quelques touches printanières. Les branchages qu’il aura fallu écarter pour se frayer un chemin se referment sur nous et, autant qu’ils soustraient de notre vue le paysage urbain ils nous soustraient de lui et l’on se sent disparaître. Au cœur du terrain vague, le symbole de la maîtrise des hommes sur la nature, la matière et le temps
s’étiole 7. Le terrain vague est finalement l’opposé du monde construit et normé qui entoure le citadin, bien que son existence y soit inextricablement liée. Ce n’est pas la ville, c’est un espace autre. S’y mêlent alors deux sentiments : celui d’avoir la liberté de faire ce que l’on souhaite, et une effroyable sensation de vulnérabilité.
Traces, bribes et brides
Y mener l’enquête n’est pas aisé. Les terrains vagues sont difficiles à aborder, il n’y a pas de porte d’entrée, pas d’accueil, pas de structure. Il s’agit d’espaces qui ne sont pas formellement régis par une institution pourvoyant des droits d’entrée ou de sortie et des horaires pouvant moduler usages et usagers. Il ne s’agit pas non plus d’espaces publics, de lieux de passage ou de flux où peuvent s’observer foules et passants. Les terrains vagues sont des espaces inutilisés par les instances régisseuses d’un espace urbain dense et en raréfaction. Aucune activité ne s’y tient officiellement et aucune activité ne devrait s’y tenir.
On est en droit de se demander ce qu’un anthropologue fait ici, ce qu’il y cherche, ce qu’il espère y trouver. Devrait-il céder ce champ aux écologues, architectes, urbanistes ou géographes, que l’on imaginerait plus à même de traiter des questions relatives à l’espace ? Ne devrait-il pas s’enquérir d’un peuple, d’une population, d’une communauté, d’un groupe, au moins d’une poignée d’individus ? À défaut d’humains à sonder, ne devrait-il pas plutôt questionner les productions de ceux-ci ?
Pourtant, des traces, comme autant de preuves, semblent indiquer de multiples usages de ces espaces. Des herbes couchées, foulées du pied, indiquent un passage récent, occasionnel ou fréquent selon l’état de la végétation qui aura plus ou moins opéré une convalescence suite à des pas indélicats. Des canettes de bières, mégots de cigarettes, sacs plastiques, emballages de nourriture, seringues et préservatifs sont autant de traces de plaisirs consommés. Ci et là des cendres trahissent un foyer, une couette suggère un couchage, des excréments un lieu d’aisance.
Mais si ces traces stimulent l’imagination du chercheur, semblent fournir des pistes, elles ne peuvent totalement révéler le caractère des usages. Après tout, ces objets peuvent avoir été utilisés ailleurs et déposés ici, et restent difficiles à mettre dans une correspondance temporelle, car rien ne permet de contextualiser leur utilisation. Seule une pensée archéologique peut ainsi prétendre faire « parler » les objets et les traces. Il faut donc se mettre en quête de porteurs de paroles et d’usages à observer.
Pour ce faire, il faut « camper » à proximité des terrains vagues, être à l’affût des apparitions furtives. Il faut alors se montrer opportun, tenter une approche, se présenter, proposer un entretien. Mais lorsque le regard indiscret n’est pas éconduit hors de la friche par une patrouille d’agents de sécurité, il déclenche souvent un départ précipité du terrain vague. D’autres fois, lorsque l’approche peut se faire, ce sont les questions qui sont indiscrètes et provoquent la défiance — « Pourquoi tu me poses ces questions ? T’es qui toi ? » — et font avorter la discussion. La poursuite dans une configuration plus formelle de l’entretien est souvent bottée en touche par les personnes rencontrées. Ainsi, lorsque je propose à des personnes qui se promènent ou promènent leur chien de les revoir pour un entretien, les réponses varient mais se ressemblent : « Ça ne m’intéresse pas », « De toute façon je ne viens jamais ici ». Les propositions d’échange de coordonnées révèlent souvent une certaine méfiance :
Voilà ce qu’on va faire : c’est moi qui vais prendre ton numéro et je te rappellerai.
Bien entendu, le chercheur a longtemps attendu que son téléphone sonne. Apparaissent alors les mêmes difficultés que celles rencontrées par Patrick Bruneteaux et tout se passe ainsi comme si cette population ne pouvait pas "entrer" dans le cadre de l’entretien formel
8.
D’autres fois, l’incompréhension règne sur les intentions du curieux, de cet étrange poseur de questions à propos de cet étrange endroit. Ce fut, parmi d’autres, le cas de cet homme posté en bordure d’un terrain vague et y portant un long regard à qui, lorsque je lui demandai après quelques mots échangés si il y entrait parfois, sembla d’abord ne pas comprendre. Puis, lorsque j’en vins à préciser ma pensée, lui disant que j’étais intéressé par ces endroits, fit quelques pas en arrière accompagné d’un rire gêné, s’exclama « Oh je vois ! » puis, me tournant le dos, ajouta « Non, non, j’ai compris, merci » avant de s’enfuir. Dans cet espace libre de toute contrainte, les questions sont incongrues en ce qu’elles laissent supposer une obligation de réponse à une norme implicite, mais l’incongruité est ici redoublée par les représentations attachées au terrain vague. Je ne saurai jamais à quelle trace ses pensées se sont attachées, s’il a pensé que je venais ici pour me droguer ou pour avoir des relations sexuelles et que je le sollicitais en ce sens.
Néanmoins, au delà des difficultés méthodologiques à étudier un espace informel et de la pratique du terrain à l’aveugle, les esquives, les excuses, les malaises donnent des pistes au chercheur quant à l’appréhension des terrains vagues. Lieux d’innombrables représentations et fantasmes, lieux que l’on a du mal à penser et à formuler, mais aussi lieux secrets, lieux de l’intime.
Pour s’en saisir, il faut se défaire quelques peu des canons de l’enquête classique et s’outiller d’entretiens informels 9 et d’observations flottantes 10. Les matériaux recueillis sont alors composites, parfois glanés en d’autres espaces-temps. Le terrain peu conventionnel appelant alors, par affinités électives, à des méthodes peu conventionnelles.
Où le regard ne porte pas
Non loin de l’entrée d’un terrain vague, deux informateurs attiraient mon attention sur un sac poubelle noir qui se confondait avec peine parmi les ronces. De nombreuses ordures parsemaient le seuil du terrain, mais, coutumiers de cet espace, ils furent intrigués par ce sac qui semblait avoir été maladroitement dissimulé là où d’ordinaire on ne prenait pas cette peine.
Regarde ça cette pauvre bête jetée comme une ordure dans un sac poubelle ! Y’a pas de respect.
Dans le sac poubelle gisait un chien. À une dizaine de mètres, l’un d’entre eux s’adonnait à une fouille, il tira d’entre les orties un document superficiellement brûlé :
Regarde, le passeport du chien ! Il a essayé de le cacher.
Demandant alors pourquoi ce chien avait été jeté ici, l’explication fut simple :
Ici, si tu veux te débarrasser de quelque chose pour que personne ne le trouve, personne ne va le trouver !
Les terrains vagues sont chargés de fantasmes et parmi ceux-ci se trouve celui du trou noir. Le 15 janvier 1947 à Los Angeles, un fait divers allait illustrer cette fonction qu’on semble leur attribuer. Une jeune fille venue tenter une carrière d’actrice à Hollywood sera retrouvée morte, tuée dans un endroit inconnu puis déposée dans un terrain vague. L’affaire du Dahlia Noir, qui ne sera jamais résolue et reste aujourd’hui encore des plus mystérieuses, fera alors grand bruit et alimentera journaux friands de faits divers, romans et films tout comme il marquera de manière durable la culture populaire 11. Ces espaces sont ainsi de temps en temps vedettes de faits divers, d’autres criminels y auront trouvé ici la possibilité, pensaient-ils, de faire disparaître les objets de leurs méfaits. D’autres preuves s’y rencontreront au gré des sorties sur le terrain comme des carcasses ou pièces de voitures désossées.
À l’heure des sociétés de contrôle 12 où tout un chacun peut être observé par des caméras — toujours plus nombreuses — qui scrutent nos villes et des villes où l’urbanisme de prévention situationnelle sculpte le paysage de manière à ce qu’on ne puisse s’y camoufler 13, les terrains vagues semblent bien plus encore représenter des espaces hors-radars inespérés. C’est ainsi que non loin de grands ensembles, j’apercevais des adolescentes qui discutaient et fumaient en bordure du terrain. Amusées par l’échange impromptu et ma curiosité ridicule, elles concédèrent à me livrer quelques éléments précieux. À la question Pourquoi venez-vous ici ?
, la réponse, comme une évidence lancée à l’ignorant fut instantanée et sans équivoque :
Bah on vient ici pour pas que les gars du quartier nous voient ! [...] Si on nous voit en train de fumer on est cramées, c’est pour ça qu’on vient ici. Ici on est tranquilles, on nous voit pas.
La crainte d’être « cramées », que les garçons « disent des trucs » si elles sont vues en train de fumer, témoigne du climat de contrôle social sexué qui peut se tenir dans l’espace des cités de banlieues populaires. Comme le note Laurence Buffet, l’architecture des quartiers favorise souvent cette forme de surveillance, à cause de la fermeture des bâtiments sur eux-mêmes 14
. Vivant dans un « clos », ces jeunes filles sont ainsi en permanence soumises au contrôle dans le quartier et sous la crainte des rumeurs pouvant circuler à leur encontre, tant être dehors à ne rien faire est mal vu et renvoie à l’image des filles de mauvaise vie 15
. L’espace de la cité étant majoritairement occupé par les jeunes hommes qui « squattent » les espaces publics du quartier, on comprend qu’ils représentent alors les regards auxquels il faut se soustraire, faire en sorte que « les gars du quartier » ne les voient pas.
Dans la mesure où évoluer dans la proximité du quartier signifie évoluer sous le regard
, où les filles se trouvent sous le contrôle du frère qui a été investi de cette fonction de surveillance, lui dont la présence dans l’espace public est légitime 16
, le terrain vague fait figure d’espace alternatif, où le regard ne porte pas et où il est possible de réaliser une pratique qui leur est interdite dans l’enceinte de la cité.
Outre pour fumer sans se faire voir, les terrains vagues peuvent aussi être un lieu pour boire. Assis sur un tas de briques, Doga s’enfilait quelques bières. C’était l’une des premières fois que je le voyais mais je l’avais déjà croisé dans les jardins informels que certains habitants du quartier, dont lui-même, ont construit dans la friche. Selon eux, il allait boire dans le terrain plutôt que dans le jardin pour ne pas boire devant sa famille, car c’est une question de respect
. Dès lors, le terrain permettait ici de ne pas se dévoiler face à sa famille, que l’on tient éloignée de cette pratique par respect, par crainte aussi de figurer comme un mauvais père, un mauvais mari, un mauvais fils, un mauvais musulman. La consommation régulière d’alcool est un petit plaisir qu’il faut garder secret, par préservation de son honneur et de ses proches.
Et puis, il y a des endroits et des personnes de la cité qu’il vaut mieux ne pas fréquenter
. Il préférait venir boire quelques bières ici après le travail car ici il pouvait être tranquille
. D’après lui, il valait mieux boire ici que d’aller au café, car là-bas on finit alcoolique
tandis qu’ici il peut rester et penser à des choses
après le travail. Comme l’écrivait Colette Pétonnet, l’homme est un animal grégaire qui ressent de temps à autre le besoin d’un moment d’intimité. Or en ville il ne lui est guère possible de se soustraire à tant d’yeux, tant de visages, de rapprochements indésirés 17
. Au milieu des grandes barres d’immeubles, la friche fait figure de troisième option entre la sphère familiale privée et intime de l’appartement (et par extension et intermittence du jardin) et la sphère publique, considérée comme pathogène, de la cité et des bars. Il s’agit d’un entre-deux, d’un espace intérieur-extérieur, ni vraiment dans la cité, ni vraiment en dehors, ni vraiment public, ni vraiment privé, mais résolument intime et personnel de par l’expérience et l’appropriation individuelle que l’on en fait.
La cabane au fond de la friche
De nombreuses autres utilisations des terrains vagues ont pu être relevées au cours de l’enquête et il serait vain de tenter ici d’en faire l’analyse. Notons simplement de manière non exhaustive la variété des situations rencontrées ou relatées comme fumer, boire, pique-niquer, dresser son chien, écouter les oiseaux, avoir des rapports sexuels, jouer, faire du moto-cross, se droguer, etc. Si certaines de ces pratiques sont ostensiblement déviantes, d’autres — banales pourrait-on penser — comme boire et fumer, ne se révèlent déviantes qu’après analyse. Aussi est-il nécessaire de se demander pourquoi elles sont pratiquées ici, dans cet espace si particulier. Se serait-on permis d’avoir un chien sans avoir de terrain pour le promener ? Comment avoir des relations sexuelles avec son partenaire lorsque le domicile familial est sous surveillance et qu’une chambre d’hôtel est financièrement inaccessible ? Où pique-niquer lorsqu’on a une mobilité réduite et que le paysage alentour se résume à une forêt de béton ? En réalité, toutes ces pratiques traduisent l’expression d’une chimère qui n’aurait peut-être pas trouvé d’autre lieu pour se réaliser. En ce sens, les terrains vagues abritent des utopies localisées, des hétérotopies 18.
Parmi ces hétérotopies se cultive celle d’un jardin. Au milieu du terrain, quelques tôles se distinguent à peine, avalées par une végétation gourmande.
Photo 1 - Crédits : Sébastien Deprez
D’un point de vue surplombant, il reste difficile de deviner la vingtaine de jardins « spontanés » installés au cœur de cette friche.
Crédits - Sébastien DeprezJ’ai fait comme ça, j’ai dit : attends... j’vais faire un jardin ! Parce que moi j’ai rien ! Tu sais, moi j’suis pas le gars qui va au café ou... qui va au cinéma. Quand je sors du boulot, je reste à la maison sinon je sors faire des tours comme ça, sinon j’vais... prendre un bout de terrain.
Depuis, une vingtaine de jardins ont fleuri autour de celui de Tarik en une dizaine d’années. La friche, il s’y promenait de temps en temps déjà en 1999, lui qui, la cinquantaine, venait d’arriver en France et était à l’époque sans emploi. Il n’aimait pas la cité dans laquelle il venait d’atterrir, ce fut pour lui un choc : ces tours là, c’est dégueulasse !
Alors se promener dans ce terrain vague l’aidait à supporter, il y trouvait un lien avec la nature. Et puis, trois ans plus tard, un déclic. Le terrain est abandonné, des pruniers et des framboisiers offrent leurs fruits au milieu des plantes colonisantes, ce doit être une bonne terre, pourquoi ne pas y faire un jardin ? Avec un bout de ficelle, il a délimité une parcelle puis l’a défrichée. Plus qu’une terre cultivable, cette parcelle est progressivement devenue une extension de son appartement en HLM. Aux quelques tôles ondulées qui permettaient de s’y abriter de manière précaire ont succédé des installations plus pérennes. Un voisin ayant lui aussi cédé aux jardins du maquis l’a aidé à glaner sur les chantiers alentours. Durant plusieurs semaines, ils ont collecté les matériaux nécessaires à la construction de cabanes.
Photo 2 - Crédits : Sébastien Deprez
Les constructions sont composites, faites de matériaux de récupération provenant souvent des chantiers alentour. Outre cette source providentielle, les occupants activent d’autres ressources, relationnelles (un ami ou un cousin travaillant dans le bâtiment), pour s’approvisionner en matériaux de construction. Ici, un voisin menuisier a fourni des portes vitrées glanées sur un chantier. La friche n’étant évidemment pas alimentée en eau, les occupants ont dû développer différentes stratégies de récupération des eaux. Dans ce cas, une cuve est connectée à l’écoulement des eaux de la toiture. Cette réserve sert à arroser le potager.
Crédits - Sébastien DeprezPhoto 3 - Crédits : Sébastien Deprez
Les habitants de la friche sont dans une situation « précaire », essentiellement liée à l’impossibilité de prévoir leur avenir. Cette instabilité interdit tout investissement important pouvant, d’un jour à l’autre, disparaître sous les coups de pelleteuses. L’aménagement d’une pièce de la « cabane » se fait dès lors à partir de mobilier de récupération. Néanmoins, le soin apporté à l’agencement du mobilier et la présence d’éléments de décoration trahissent une appropriation très personnalisée de l’espace et une projection dans l’avenir.
Crédits - Sébastien DeprezEt puis, entre les arbustes, il a progressivement — à l’aide de planches et de tapis — esquissé un chemin reliant son jardin à l’extérieur de la friche, quitte à trahir sa présence.
Photo 4 - Crédits : Sébastien Deprez
Un chemin de tapis mène aux jardins. De ce point de vue, on aperçoit les bâtiments surplombant la friche où vivent la majorité des jardiniers.
Crédits - Sébastien DeprezSa femme, d’ordinaire coincée au quatrième étage sans ascenseur de leur appartement en raison de son handicap allait trouver ici la possibilité de prendre l’air. Dorénavant, les après-midis d’été passées à l’ombre des figuiers du pays et de leurs fruits mûrs avaient une toute autre saveur. Un jardin, c’est ce dont Tarik avait toujours rêvé :
Moi si je gagne à l’Euro Millions je prends une maison avec un grand jardin et je m’isole de tout. Je prends des poules, des moutons, des chèvres...
Photo 5 - Crédits : Sébastien Deprez
Erman, un voisin de Tarik, promène un bouc. Derrière, l’un des chemins menant aux jardins. Les clôtures sont elles-aussi composites, constituées de matériaux récupérés ça et là. Dans cette zone, une porte a été mise à l’entrée du chemin et un tapis fait office de seuil. Quelques membres de la famille de Tarik ont ici aussi « pris un jardin » et Erman fut le premier voisin de Tarik. Le chemin est ici propre, sans déchets, les habitants de cette partie de la friche se connaissent et veillent à ce que cette partie commune soit relativement bien entretenue.
Crédits - Sébastien DeprezPhoto 6 - Crédits : Sébastien Deprez
De l’autre côté de la friche, un autre chemin distribue plusieurs terrains. À la différence de jardins partagés ou ouvriers, où une instance régit l’espace, ici les jardins se sont constitués librement, chacun venant faire sienne une parcelle de cet espace en friche. La taille et la forme des parcelles diffèrent donc grandement. Les clôtures sont disparates, de différentes hauteurs et de différentes constitutions. Souvent, l’opacité des clôtures entre les terrains traduit la qualité des relations de voisinage là où, dans les jardins partagés, les clôtures ne peuvent être opacifiantes ni dépasser une certaine hauteur afin que chaque parcelle puisse être observée. Le chemin tordu s’est forgé au gré de querelles relatives à l’espace, plusieurs habitants ayant progressivement grignoté sur cet espace à l’origine pensé comme un parking par l’un d’eux. Les parties communes délaissées témoignent ici d’une toute autre relation de voisinage que du côté de chez Tarik.
Crédits - Sébastien DeprezIl le savait, un jour ou l’autre il faudrait partir. Avec la constitution, il y a quelques années, d’une puissante communauté d’agglomération et l’imminence d’un Grand Paris qui tente d’éviter l’asphyxie 19, le terrain était récemment devenu l’objet de toutes les attentions. À quoi bon tenter de faire valoir son cas ? Devant les rêves de ces puissantes institutions, les siens seraient balayés. Néanmoins, petit à petit, malgré cette tension permanente entre espoir et résignation, fiction et rationalité, il mettait en œuvre son rêve. Une seconde cabane fut montée, puis une troisième communiquant avec la précédente. Un coin cuisine, un salon, une chambre pour faire la sieste, un cabinet. Vint un chien puis deux, une volière pour les pigeons, une autre pour les poules. Le potager fut alimenté en eau stockée par des récupérateurs et les cabanes furent alimentées en électricité par un groupe électrogène afin de permettre de longues parties de dominos nocturnes.
Photo 7 - Crédits : Sébastien Deprez
Les hommes de la famille se livrent régulièrement à des parties de dominos le soir depuis que Tarik a construit cette pièce.
Crédits - Sébastien DeprezLe manque de perspectives et de moyens financiers interdisait d’investir autre chose que des matériaux et matériels de récupération. Cependant, chaque pierre ajoutée à l’édifice serait une perte plus grande lors de la venue des pelleteuses. Car, bien plus que du matériel, des cabanes et des volières, ce sont des espaces progressivement devenus lieux de vie qui s’enfouiront sous les décombres et c’est l’investissement émotionnel qui constituera la plus grande perte.
Conclusion
Alors que l’espace public apparaît comme stérilisé 20, les terrains vagues se présentent comme des opportunités de laisser libre cours à son imagination et se définissent en conséquence. Tour à tour terrain de jeux, toilettes publiques, potager, déchetterie, lieu de commensalité́, lieu de consommation de stupéfiants et lieu de vie, ces espaces ont le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles 21
.
Mais ces hétérotopies, comme le grand lit des parents où l’on découvre l’océan puisqu’on peut y nager entre les couvertures, le ciel puisqu’on peut bondir sur les ressorts, la forêt puisqu’on s’y cache
, prennent fin au retour de Big Mother 22, lorsque de nouveau l’œil sécurisant du pouvoir se pose sur le champ des possibles...